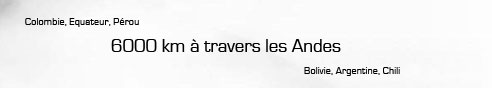Qhapaq Ñan, la route d'un empire.
Google Earth
Nécessite le logiciel google Earth.
El-Ángel
Laguna Mojanda
Quito
Cuenca
Cajamarca
Cusco
Lac Titicaca
Désert d’Atacama
Salar d’Uyuni
Canyons de Tupiza
Une route mythique oubliée des hommes
Imaginez des sections pavées de plus de 20 mètres de large, des volées d’escaliers en pierre grimpant jusqu’à plus de 4500 mètres d’altitude, des plates-formes de plusieurs kilomètres de long, des ponts suspendus accrochés aux flancs des canyons… Imaginez l’Inca, assis dans un palanquin plaqué d’or et d’argent, décoré de plumes et porté par une cours de plus de 80 hommes. La route devant lui balayée et décorée de pétales de fleurs… Imaginez enfin des coursiers à pieds, les Chasquis, qui par un système ingénieux de relais pouvaient véhiculer l’information à une vitesse incroyable d’une extrémité à l’autre de ce vaste empire…
 Le tracé principal joignait les villes de Pasto en Colombie et Santiago du Chili. Il permettait à l’Inca de contrôler son Empire et de déplacer ses troupes depuis la capitale, Cusco. Le long de cette route parfois pavée, un système ingénieusement organisé de Chasqui Wasi (poste de relais), Pukaras (forts), Tambos (auberges)…
Le tracé principal joignait les villes de Pasto en Colombie et Santiago du Chili. Il permettait à l’Inca de contrôler son Empire et de déplacer ses troupes depuis la capitale, Cusco. Le long de cette route parfois pavée, un système ingénieusement organisé de Chasqui Wasi (poste de relais), Pukaras (forts), Tambos (auberges)…
Un réseau secondaire de routes transversales, comparable au réseau de routes romaines et long de plus de 40 000 km, reliait alors le Qhapaq Ñan à la côte pacifique et au bassin amazonien.
 Les Chasquis, les coursiers à pieds, pouvaient alors, grâce à un système de relais extrêmement efficace, véhiculer l’information à une vitesse incroyable!
Les Chasquis, les coursiers à pieds, pouvaient alors, grâce à un système de relais extrêmement efficace, véhiculer l’information à une vitesse incroyable!
La majeure partie de cette route monumentale se situe à une altitude entre 3500 et 5000 mètres. Atteignant jusqu’à 20 mètres de largeur, elle reliait les zones habitées, les centres administratifs, les zones agricoles et minières ainsi que les lieux de cultes.
Ce “Chemin Principal” a permis l’unification de cet empire immense et hétérogène, à la géographie exceptionnelle, un des mieux organisés du monde sur le plan administratif. Au delà des frontières modernes, il continue de constituer ce trait d’union entre les différentes cultures andines.
Avant-propos de notre livre par Ricardo Espinosa
 Quand Laurent et Megan présentent leur marche dans les Andes, ils parlent d’un voyage vers l’inconnu. Pour un Péruvien, fils de la Pachamama et connaisseur de sa terre natale, cela peut paraître disproportionné ou exagéré. Mais, réflexion faite, il faut bien avouer qu’il y a du vrai dans cette notion. Néanmoins, elle nécessite d’être clarifiée pour ne pas être confondue avec un conte fantaisiste du XVIIe siècle.
Quand Laurent et Megan présentent leur marche dans les Andes, ils parlent d’un voyage vers l’inconnu. Pour un Péruvien, fils de la Pachamama et connaisseur de sa terre natale, cela peut paraître disproportionné ou exagéré. Mais, réflexion faite, il faut bien avouer qu’il y a du vrai dans cette notion. Néanmoins, elle nécessite d’être clarifiée pour ne pas être confondue avec un conte fantaisiste du XVIIe siècle.
Si un habitant de Lima, la capitale du Pérou, ignore tout des Andes – autant que vous lecteur ou que les auteurs eux-mêmes avant qu’ils ne s’embarquent dans cette aventure extraordinaire –, c’est plus le reflet de son ignorance que de la qualité de vie ou du dynamisme culturel, plus important que l’on ne pourrait le croire, de son pays.
Resituons les choses dans leur contexte. Dans les Andes, on consomme du Coca-Cola, on a accès à internet et on regarde la Coupe du monde de football, comme partout ailleurs dans le monde. L’inconnu réside plutôt à l’intérieur du tissu social, voire dans les monuments qui n’ont pas encore été déterrés, dans le lien qui unit l’homme aux divinités naturelles, et dans cette force fantastique palpitant silencieusement dans ses veines, qui s’est accrue durant des siècles d’exclusion. De tout cela, nous ne savons pratiquement rien.
Dix ans après mon retour à Lima, ma ville natale, je décidai d’arpenter à pied l’immense côte du Pérou, qui demeurait aussi mystérieuse que la lune, et de coucher mes découvertes sur le papier. La côte m’a beaucoup appris, en particulier les souffrances inhérentes à la marche à pied : se réveiller au 115e jour, frigorifié en plein été à l’intérieur d’une petite tente ; être paralysé du dos comme si le monde pesait sur ses épaules depuis des décennies entières, avoir les pieds trop enflés pour qu’ils entrent dans les chaussures ; sentir la faim, qui fait désormais partie de sa personnalité, et se souvenir vaguement d’avoir vécu un jour dans une maison sans avoir à porter de sac à dos et marcher vingt ou trente kilomètres quotidiennement... Dans ces conditions, arriver à se lever et marcher relève de l’exploit et n’a pas grand-chose à voir avec une bonne forme physique. C’est plus une question d’état d’esprit.
 Ce sont les habitants de la côte qui m’inoculèrent le virus des chemins anciens. Ils associaient évidemment mon sobriquet El Caminante, « le marcheur », avec les chemins de leurs ancêtres – un réseau qu’eux aussi parcouraient de long en large et qui est aujourd’hui invisible mais toujours présent et plein de sens.
Ce sont les habitants de la côte qui m’inoculèrent le virus des chemins anciens. Ils associaient évidemment mon sobriquet El Caminante, « le marcheur », avec les chemins de leurs ancêtres – un réseau qu’eux aussi parcouraient de long en large et qui est aujourd’hui invisible mais toujours présent et plein de sens.
Ainsi, après avoir exploré les chemins secondaires pendant deux ans, mon équipe et moi-même nous lançâmes à l’assaut du grand Qhapaq Ñan. Ce chemin immense et fabuleux incarnait l’ingénierie inca, un art dans lequel aucune autre civilisation n’avait pu rivaliser avec eux, même de loin, dans toute l’histoire de cette partie de l’hémisphère. De plus, sa direction nord-sud lui a donné le statut de colonne vertébrale du monde andin.
Dès les premières heures de la colonisation, les Espagnols, outre le démembrement social du territoire, imposèrent une nouvelle dynamique qui saigna ce grand corps au profit de l’Europe, en cessant de nourrir Cuzco, son plexus solaire. Cet axe qu’ils avaient abandonné nous apparaissait comme une légende faite réalité. Cinq siècles s’étaient écoulés, sans que cela ne se remarque tant sa dimension demeurait imposante !
Guidés par la main immense de ce géant endormi, qui semblait encore rêver à la grandeur des hommes qui l’avaient construit, nous fûmes récompensés au-delà de nos attentes les plus fiévreuses. La gigantesque Grande Route Inca, encore visible à des altitudes inhabitées, accidentées et solitaires, pouvait être empruntée à pied. Plus qu’un chemin, c’était un monument.
 La question qui surgissait immédiatement était : Pourquoi construire un chemin aussi majestueux ? Tracer des chemins dans ces montagnes vertigineuses, sans instruments de taille ni carte, était déjà une prouesse incroyable. Pourquoi avoir été au-delà de ce qui était indispensable ? Le réseau de routes incas, et surtout cette Grande Route à laquelle nous nous intéressons, était un signe d’autorité tant sur les hommes que sur les forces naturelles. On racontait que les peuples soumis ouvraient pour l’Inca un nouveau chemin prestigieux en signe de respect. Ainsi, ce chemin principal fut construit à un moment donné, non pas pour permettre des déplacements plus commodes et rapides, mais bien pour affirmer la grandeur du souverain qui l’utilisait.
La question qui surgissait immédiatement était : Pourquoi construire un chemin aussi majestueux ? Tracer des chemins dans ces montagnes vertigineuses, sans instruments de taille ni carte, était déjà une prouesse incroyable. Pourquoi avoir été au-delà de ce qui était indispensable ? Le réseau de routes incas, et surtout cette Grande Route à laquelle nous nous intéressons, était un signe d’autorité tant sur les hommes que sur les forces naturelles. On racontait que les peuples soumis ouvraient pour l’Inca un nouveau chemin prestigieux en signe de respect. Ainsi, ce chemin principal fut construit à un moment donné, non pas pour permettre des déplacements plus commodes et rapides, mais bien pour affirmer la grandeur du souverain qui l’utilisait.
Il faut être sur ce chemin, dans un paysage extravagant, pour réellement se rendre compte de sa majesté. Nous pourrions tenter l’expérience d’aménager une route moderne similaire. Imaginez alors un groupe d’hommes qui serait capable de construire une autoroute de douze voies, à cinquante mètres au-dessus du sol, avec tous les services imaginables, dont certains n’auraient jamais été conçus auparavant, et qui irait de Lisbonne à Moscou. C’est ainsi que les Andins de l’époque ont dû voir la Grande Route Inca.
La recherche du Qhapaq Ñan entreprise par les auteurs, la divulgation des résultats de leur expédition, et également les projets qu’ils désireront mener à l’avenir sur ce sujet sont pour moi d’une importance vitale. Ce savoir inédit est un capital qui a besoin d’être analysé et mis en ordre, mais surtout vulgarisé. En effet, c’est en médiatisant ces valeurs qu’il sera possible d’en retransmettre aux populations locales – les seules héritières de ce patrimoine – la connaissance et la gestion. Ce sera aussi le moyen de sensibiliser la communauté internationale sur l’énorme potentiel du Qhapaq Ñan à unifier et à favoriser le développement de ces mêmes populations locales.
Les actions de celui qui « a vu » la Grande Route, avec un sens de l’observation critique et professionnel et qui a la capacité de toucher un large public, seront parfois plus efficaces que celles de certaines institutions ou bureaucraties gouvernementales.

Les architectes de ces chemins, de temps à autre empruntés par leurs héritiers, voyaient le monde avec un regard que nous avons perdu, se posaient des questions que nous pensons avoir résolues et vivaient sous la protection rassurante d’une nature, que nous cherchons à assujettir sous le joug de notre arrogance scientifique. Or cette nature aurait plutôt besoin que nous cessions de la maltraiter.
Le trait d’union possible entre ces perspectives divergentes est la marche. À n’en pas douter, il existe des êtres imperméables à cette idée, mais vraisemblablement marcher entraîne chez toute personne, illustre ou pas, une identification à ce qu’elle observe et qui ressemble quelque peu à cette vision de nos ancêtres. Le marcheur s’intègre aux cultures locales, soutenu par l’hospitalité de ceux qu’il rencontre, tout en étant confronté à leurs questions existentielles et à leurs rêves. Marcher transporte dans le passé, à l’époque où ces chemins furent construits et fréquentés par les Incas. Presque rien n’a changé dans cette nature intacte.
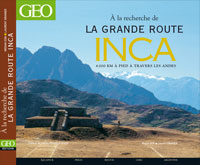 À présent, fermez donc ce livre et lancez-vous sans plus tarder sur un de ces chemins ! Épuisé, mais rempli d’énergie, vous serez plus à même d’en saisir l’essence. Une leçon du passé pour apprendre à lier, à tous les niveaux, les peuples entre eux, l’homme et la nature et l’homme avec lui-même.
À présent, fermez donc ce livre et lancez-vous sans plus tarder sur un de ces chemins ! Épuisé, mais rempli d’énergie, vous serez plus à même d’en saisir l’essence. Une leçon du passé pour apprendre à lier, à tous les niveaux, les peuples entre eux, l’homme et la nature et l’homme avec lui-même.
Ricardo Espinosa, les Andes, mars 2008